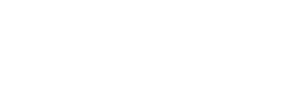Myriam a grandi sous les bombes d’Alep en Syrie. Aujourd’hui âgée de 13 ans, elle publie, avec le journaliste Philippe Lobjois, “Le Journal de Myriam”, un témoignage inédit sur le huis clos de la guerre et une enfance déchirée.
Elle s’appelle Myriam, elle a 13 ans aujourd’hui. Comme de nombreuses petites filles de son âge, elle confie son quotidien à un journal intime. Comme de nombreuses petites filles de son âge, elle consigne tout, les rires, les pleurs, les anniversaires, les amitiés…. Myriam n’est pourtant pas tout à fait comme les autres, elle est syrienne. Son quotidien, ses souvenirs, ses émotions, tout ce qu’elle couche minutieusement sur le papier se noue dans un pays en guerre. Dans “Le Journal de Myriam”, publié aux éditions Fayard, Myriam Rawick raconte le chaos à Alep-Ouest, zone sous contrôle gouvernemental, en Syrie, de novembre 2011 à décembre 2016. Un témoignage inédit recueilli par le reporter de guerre Philippe Lobjois. En décembre 2016, il décide de se rendre en Syrie, pays qu’il ne connaît pas, pour comprendre cette guerre que personne ne raconte de l’intérieur. Il rencontre alors Myriam et sa mère Antonia à la congrégations des frères maristes bleus à Alep-Ouest, dans la zone sous contrôle gouvernemental.
À voir “Maintenant, je n’ai plus peur à Alep”
“Dans un petit cahier d’écolier, Myriam avait consigné sur une cinquantaine de pages des anecdotes pour se souvenir de ce qu’ils avaient vécu”, explique Philippe Lobjois. Des souvenirs que le journaliste a enrichi avec la jeune Aleppine en l’interrogeant sur des évènements importants, comme la chute de la citadelle.
Myriam grandit à Jabal Saydé, aussi connu sous le nom de Cheikh Maqsoud, un quartier d’Alep-Ouest à majorité kurde. Originaire d’Arménie, la famille Rawick s’est installée en Syrie en 1915 après avoir fui le génocide en Turquie. Dans ses pages écrites en arabe, la fillette raconte les glaces à la rose, les mahallabieh, les brochettes au cumin… Un véritable “paradis de couleurs, d’odeurs, de saveurs”… jusqu’aux “évènements”. Au début, il s’agit de quelques manifestations à Damas, puis à Alep. Malgré les efforts de sa mère pour la préserver, elle aperçoit les images lorsque les adultes regardent la télévision. Les mines sont fermées, l’air inquiet.
Les bons vs les méchants
Les semaines passent. Les manifestations se poursuivent mais à présent, elle entend des coups de feu. Myriam essaye de comprendre en écoutant “la dame des informations”. En vain. “Il y a ceux qui sont pour le président. Ceux qui sont contre. Ils s’affrontent dans tout le pays. Mais la télévision syrienne dit que ceux qui sont contre sont des musulmans dangereux payés par l’Arabie saoudite. Quand papa et maman changent de chaîne, on dit que les manifestants sont pacifiques et que c’est le gouvernement qui leur tape dessus. Je ne comprends rien”, écrit-elle. Les bons et les méchants. Des mots d’une simplicité déconcertante qui résument cependant bien la lecture manichéenne de ce conflit qui a fait aujourd’hui plus de 400 000 morts.
“En Occident, y compris dans les médias, dès le début de la guerre en 2011, on a considéré que Bachar al-Assad était le méchant et ceux d’en face, l’Armée syrienne libre (ASL) et les rebelles, étaient les gentils, analyse le reporter. On est alors en pleine période des printemps arabes et la France, comme les États-Unis, a décidé qu’il fallait que le président syrien dégage. Six ans après, il est toujours en place et une large partie de la population qui voulait son départ, même si elle aspire à davantage de libertés, ne veut surtout pas de ceux d’en face. L’idée était de donner la parole à des gens qu’on n’a jamais entendus, ceux du camp loyaliste”.
Au fil des pages, sans jamais parler de guerre, la petite fille évoque l’enlèvement de son oncle Fadi, les larmes, la tristesse, la “rançon” payée pour le faire libérer. Dans sa bouche d’enfant résonnent bientôt des mots d’adultes : kalachnikov, douchka, tirs, sniper, bombe, mortier… Myriam voit son quotidien changer. On l’accompagne à l’école, quand elle peut y aller. Un véritable crève-cœur pour cette élève modèle. Mois après mois, elle raconte les coupures d’électricité, d’eau, les prix des denrées alimentaires qui flambent, comme celui du gaz. Les journées passées dans la cage d’escalier de l’immeuble ou dans le sous-sol de l’école. Et puis il y a la peur. Celle qui lui donne mal au ventre et qui la fait vomir lorsque les premières explosions surviennent dans son quartier de Jabal Saydé. Parfois, aussi, quelques larmes. Mais jamais Myriam n’évoque ses émotions avec des mots crus. On se prend même à sourire en lisant les subterfuges psychologiques qu’elle échafaude pour vaincre la peur en courant sur la ligne de front, point de passage obligé pour rejoindre son quartier. “J’ai serré les lanières de mon cartable très fort. Je me suis dit que, s’il était bien accroché sur mon dos, je serais protégée des balles et des éclats”, écrit-elle.
La douleur de l’exil
En 2013, la famille de Myriam est contrainte à l’exil. Les “terroristes”, mot qu’elle emploie peu dans ces 295 pages, sont entrés dans son quartier. Ils portent “des masques noirs et des bandeaux blancs autour du front”. Il faut partir, tout laisser derrière soi. “[Avec Joëlle, ma petite sœur], nous avons dit au revoir à toutes nos poupées, regroupées dans une grande valise ouverte. Nous leur avons fait un gros bisou à toutes en leur disant qu’on espérait les revoir bientôt et qu’on ne les laisserait pas longtemps toutes seules”.
Myriam plonge le lecteur dans une réalité souvent ignorée : la partie ouest de la ville, pourtant loyale au président syrien, a elle aussi été assiégée. “Pendant 5 ans, on a cru que c’était les loyalistes qui assiégeaient Alep-Est, en fait c’était le contraire, souligne Philippe Lobjois. L’ASL et les islamistes, qui détenaient quasiment 70 % de la ville, assiégeaient ce minuscule quartier d’Alep-Ouest. C’est seulement à partir de juillet-août 2016 qu’il y a eu une inversion complète : les loyalistes, avec l’armée russe, ont commencé à bombarder tous les quartiers détenus par les rebelles et l’ASL. Là, c’était eux qui étaient assiégés. En Europe, personne n’avait vraiment compris ça”.
Avec le blocus, Myriam ressent encore plus la faim. Les mois passent et les bombes se font toujours plus menaçantes. “Je ne reconnais plus Alep quand je traverse la ville, écrit-elle en mars 2015. (…) les immeubles ont presque tous perdu deux ou trois étages qui dégoulinent sur le sol. On croise des barrages, des gens armés”. Myriam égrène les histoires de décès. Survivre est de plus en plus difficile. Les Aleppins se sentent abandonnés, livrés à leur triste sort. À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le frère mariste Georges rappelle ainsi que les enfants d’Alep sont les grands oubliés du conflit. Une colère silencieusement assourdissante. L’image des 30 petites victimes de l’attaque chimique d’Idlib le 6 avril 2017, puis des 68 enfants brûlés vifs dans un bus dix jours plus tard lors d’une évacuation à Alep ont fait la une des journaux du monde entier. La ligne rouge avait été franchie depuis si longtemps avant que le monde ne s’indigne vraiment. C’est cela aussi que Myriam renvoie au lecteur. Si elle a eu la chance d’être préservée par ses parents, qui ont tout fait pour maintenir un semblant de vie normale, combien n’ont pas eu sa chance ?
Lorsqu’Alep est libérée, Myriam n’a qu’une hâte : retourner dans son quartier de Jabal Saydé. Le 22 janvier 2017, c’est en compagnie de sa mère qu’elle découvre un champ de ruines. Dans leur appartement dont presque plus rien ne subsiste, elle retrouve quelques jouets. “C’est là pour la première fois que j’ai compris ce que signifiait la guerre. La guerre, c’était mon enfance détruite sous ces ruines et enfermée dans une petite boîte”. La guerre à hauteur d’enfant. Tout simplement.
“Le Journal de Myriam”, la guerre en Syrie à hauteur d’enfant
29-06-2017 10:54 AM

(Visited 85 times, 1 visits today)