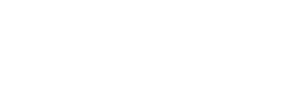Pratiquée depuis l’Antiquité, la « restitution » des monuments détruits par les hommes ou abîmés par le temps suscite un intérêt croissant dans le monde, du Japon au Mali en passant par l’Allemagne. Elle n’en fait pas moins l’objet de vives controverses en France.
En 2016, deux projets ont bénéficié d’une ample couverture médiatique : la « restitution » des antiquités de Palmyre et, plus localement, celle de la flèche de labasilique Saint-Denis. Un point complet sur cette question s’impose.
Alors que le patrimoine monumental avait été entretenu pendant des siècles sans service spécialisé et en reconduisant peu ou prou les dispositions anciennes des ouvrages, les destructions de la Révolution et les profondes mutations sociales du début de l’ère industrielle entraînèrent une prise de conscience nouvelle.
Des voix s’élevèrent contre la disparition de monuments insignes, notamment Victor Hugo qui relança le goût de ses contemporains pour le Moyen Âge et le patrimoine avec Notre-Dame de Paris et publia Guerre aux démolisseurs ! en 1834.
Cette mobilisation intellectuelle se traduisit administrativement par la création de la Commission des Monuments historiques, en 1837. Les premières réflexions sur la restauration patrimoniale en découlèrent.
Eugène Viollet-le-Duc préconisa des interventions plus fondamentales, qui allèrent jusqu’à réinventer des parties entières de monuments, comme il le fit à Saint-Sernin de Toulouse et au château de Pierrefonds. Il théorisa son action dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française.
Dès la fin du XIXe siècle, un tel débordement n’était plus d’actualité. En France même, ses excès eurent pour effet de fermer les conservateurs du patrimoine à toute idée de restitution.
Succédant à ces premiers penseurs et porté par une sincère volonté de conservation, Camillo Boito introduisit l’idée qu’une intervention sur des vestiges archéologiques devait être visible, pour éviter toute confusion entre les ouvrages neufs et anciens. Ces notions furent reprises en 1931 par la Charte d’Athènes pour la Restauration des Monuments historiques. C’est le premier document international concernant la restauration des monuments anciens (*).
En 1964, la Charte de Venise la compléta, même si plusieurs de ses affirmations continuaient de faire débat. Le texte reconnaissait l’intérêt de restituer des ouvrages disparus, s’ils étaient correctement documentés, mais il préconisait le remplacement des parties manquantes selon « une intégration harmonieuse à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales ».
Les pays les plus touchés par la guerre, comme l’Union soviétique, l’Allemagne et la Pologne, n’acceptèrent pas un document qui niait à ce point les blessures dont ils venaient d’être victimes. Ils souhaitaient pouvoir reconstruire leur territoire, villes et monuments « com’era, dov’era » afin de retrouver leur histoire et leur identité injustement détruits et effacés. En 1982, la Déclaration de Dresde accepta et même encouragea la reconstruction des monuments détruits par des faits de guerre.
Rédigée principalement par des Occidentaux, la charte se voulait universelle mais s’inscrivait dans une logique néo-coloniale en ne considérant pas les différences culturelles.
Les Japonais, qui avaient comme tradition de reconstruire à l’identique, tous les vingt ans depuis le VIIIe siècle, un des sanctuaires les plus sacrés du pays, le temple d’Isé, jugèrent à leur tour la Charte de Venise inadaptée. La notion d’authenticité de matière, essentielle aux yeux des européens et dans la Charte de Venise, ne convenait pas à la reconstruction régulière d’un monument, dont l’une des finalités était la transmission des savoir-faires d’une génération à l’autre.
En 1994, le Document de Nara ouvrit une interprétation plus large et plus nuancée de la notion d’authenticité en intégrant notamment la notion d’authenticité de la forme.
Enfin, la Déclaration de Paris, en 2011, redonna aux savoir-faire traditionnels de la restauration une place de premier plan. La Charte de Venise fut donc considérablement renouvelée et enrichie par de nombreux textes additionnels.
Toutefois, en France, le souvenir des interventions abusives de Viollet-le-Duc, encore très présent, empêcha qu’ils soient pris en considération.
Encouragée par les restrictions budgétaires du ministère de la Culture, une surinterprétation de la Charte de Venise finit même par prévaloir, récusant pour des raisons presque morales toute restitution et imposant un traitement contemporain des ouvrages restaurés.
(Visited 71 times, 1 visits today)