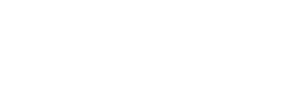Dans l’affaire WikiLeaks – la “mère de toutes les fuites”, aurait pu dire l’Irakien Saddam Hussein, il y a ceux qui dramatisent et ceux qui relativisent. Ces derniers ont sans doute raison.Parmi les premiers, la secrétaire d’Etat, Hillary Clinton, bien sûr. Elle dénonce, non sans quelques arguments, un acte irresponsable, portant un coup très dur à la diplomatie américaine. Il va falloir “ramer” pour réparer les dégâts. Des centaines de télégrammes diplomatiques américains exposés au grand public laissent des traces : alliés choqués par les jugements portés sur eux ; partenaires devenus méfiants ; informateurs sur leurs gardes, etc. La transparence n’est pas mécaniquement une vertu. “Les gouvernements, comme les couples, ont droit au secret”, écrit Richard Cohen du Washington Post. C’est une référence : en 1974, le Post a poussé un président américain, Richard Nixon, à la démission en le forçant à rendre publics les enregistrements de ses propres conversations dans son bureau de la Maison Blanche…Mme Clinton a des raisons toutes particulières d’être en colère. Le “détournement” a eu lieu chez elle, au département d’Etat. Version des faits non confirmée, mais la plus répandue dans la presse : un jeune analyste de 25 ans, Bradley Manning, est soupçonné d’être à l’origine de la mégafuite. Il avait accès au site du département d’Etat sur lequel étaient stockés les 250 000 télégrammes. Il n’était pas le seul. Quelque 900 000 à 3 millions de fonctionnaires américains pouvaient aussi y prétendre, directement ou indirectement. Cela fait beaucoup de monde et relativise la notion de secret. Formé au temps de la guerre froide, le secrétaire à la défense, Robert Gates, n’est pas aussi catastrophé qu’Hillary Clinton. Il reconnaît que certains des télégrammes sont “maladroits “. Il ne dit pas lesquels. Ceux, par exemple, enjoignant aux fonctionnaires américains en poste à New York, à l’ONU, d’exercer sur leurs collègues étrangers une surveillance relevant plus de l’espionnage que de la diplomatie ? Il admet que les Etats-Unis vont, ici et là, se trouver dans une situation “embarrassante”. Mais, dans l’ensemble, dit Robert Gates, les conséquences de toute l’affaire seront “relativement modestes” pour la diplomatie américaine. C’est le plus probable. Pourquoi ? La première raison tient à la teneur générale des télégrammes – du moins les quelques centaines qu’on a pu lire. Si Julian Assange, l’animateur de WikiLeak, voulait, comme il l’a proclamé dans sa quête de transparence absolue, mettre à jour le caractère scandaleux, impérialiste et génétiquement malfaisant de la politique étrangère américaine, c’est raté. La tonalité générale est celle d’une diplomatie talentueuse – on a le sens du portrait psychologique au département d’Etat -, réaliste, parfois laborieuse, attachée à défendre les intérêts de l’Amérique par les voies de la négociation. Avec The Guardian, Der Spiegel, El Pais et Le Monde, le New York Times a choisi de publier en exclusivité des comptes rendus analytiques de certains télégrammes. Dans l’éditorial qu’il consacre à l’affaire, le Times écrit : “Ce qui nous frappe, et qui nous rassure, c’est l’absence de malhonnêteté (dans la conduite de la politique étrangère américaine). Après des années de révélations sur les abus de l’administration Bush – de l’utilisation de la torture aux enlèvements -, ce que les télégrammes révèlent de la diplomatie Obama, ce sont des tractations appropriées et, parfois, sacrément intelligentes.” Rien de l’océan de corruption, de fourberie et de noirs complots qu’avait promis WikiLeaks. Ancien journaliste et ancien diplomate, spécialiste des questions stratégiques, aujourd’hui président du Council on Foreign Relations, le temple de l’establishment américain en matière de relations internationales, Leslie Gelb porte le même jugement. Avec ces télégrammes, “vous avez sous les yeux ce à quoi WikiLeaks ne s’attendait pas, écrit-il sur le site The Daily Beast ; vous avez un pays, les Etats-Unis, qui s’efforce sérieusement, professionnellement, d’obtenir des solutions pour certains des problèmes les plus dangereux et les plus compliqués qui se posent au monde”. C’est un point de vue américain, bien sûr. Mais dès lors qu’on admet que la politique étrangère d’une grande ou d’une moyenne puissance est la défense de ses intérêts nationaux dans le monde, et non pas la promotion d’un catalogue d’actions de grâce, il n’y a pas de raison de ne pas y souscrire. D’autant plus que les télégrammes donnent de l’ Amérique d’Obama, non pas l’image d’une hyperpuissance arrogante et impériale, mais tout le contraire. Ce qui ressort de la lecture de WikiLeaks, comme le dit encore Gelb, c’est le portrait d’une Amérique qui “n’a pas le pouvoir de dicter ses solutions”. Elle doit quémander, marchander, bref, négocier avec des alliés malcommodes (Israël), des partenaires dont elle dépend pour sa dose quotidienne de pétrole (nombre d’Etats arabes), des cousins qui n’ont guère de troupes à lui prêter (les Européens), un autre Grand qui lui sert de banquier (la Chine), etc. On est loin de la Maison Blanche de George W. Bush qui croyait avoir seule, ou presque, le pouvoir de “façonner la réalité” de ce début de siècle ; loin de la crise d’hubris qui va la saisir au lendemain de la chute du mur de Berlin. Preuves à l’appui, WikiLeaks dresse le portrait d’une Amérique pragmatique dans un monde multipolaire. Passionnant, pas scandaleux.